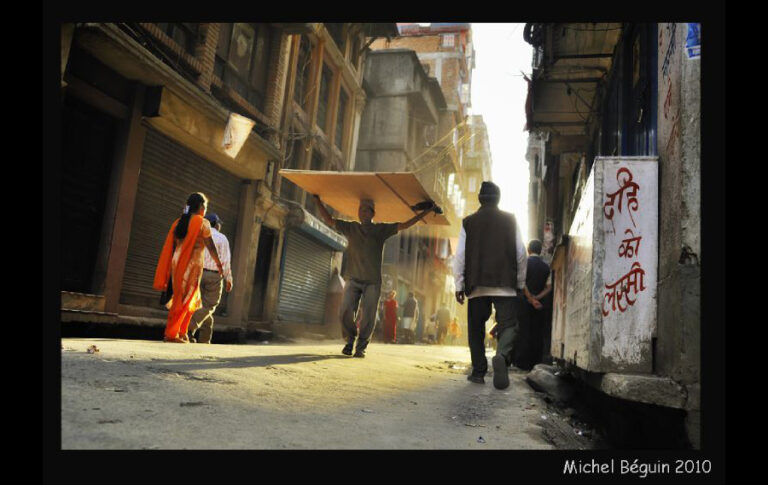Karine Pierre _ Prix RSF “Lucas Dolega-SAIF” 2023
Karine Pierre, photographe autodidacte depuis fin 2015 et membre de l’agence Hans Lucas depuis 2017, se spécialise dans la photographie sociale et politique. En 2019, elle concentre son travail à l’international, notamment sur la condition des femmes opprimées au Pakistan, où les « refuges » pour femmes deviennent des prisons, reflétant une société patriarcale violente.