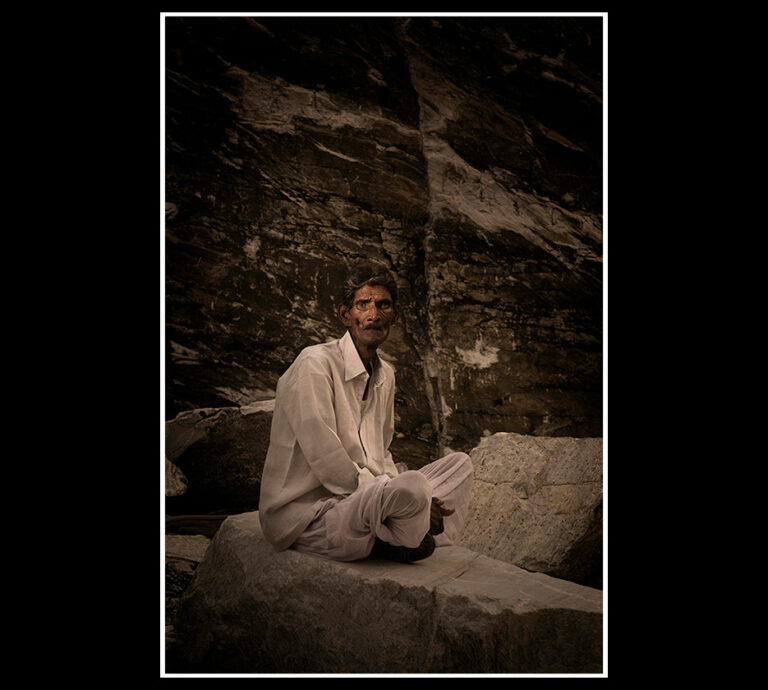Christian Barbé _ Ghana, pollution du dénuement, pollution de l’abondance
Un reportage de Christian Barbé sur les déchets de l’Europe qui s’entassent aux abords des bidonvilles ou sur les plages d’Accra, au Ghana. Des montagnes de notre civilisation polluante, mais essentielle aux habitants d’Accra. Aux abattoirs de «Bobay», le pneu utilisé comme combustible produit des fumées toxiques qui cuit les viandes prêtes à être vendues aux marchés.