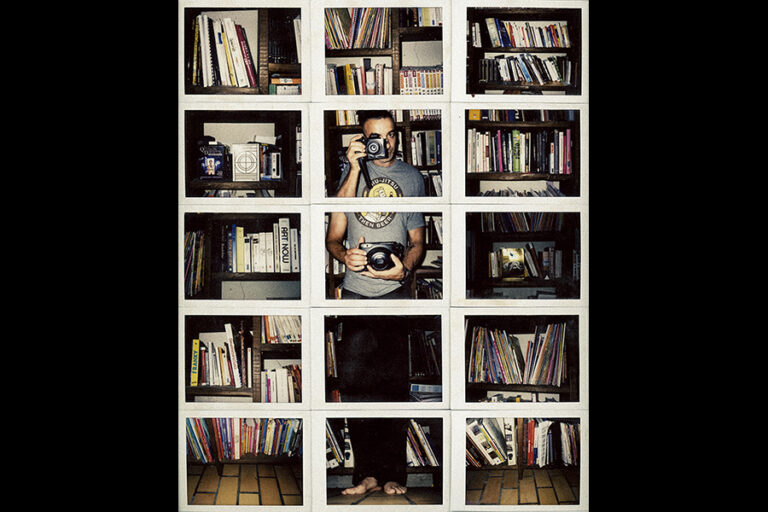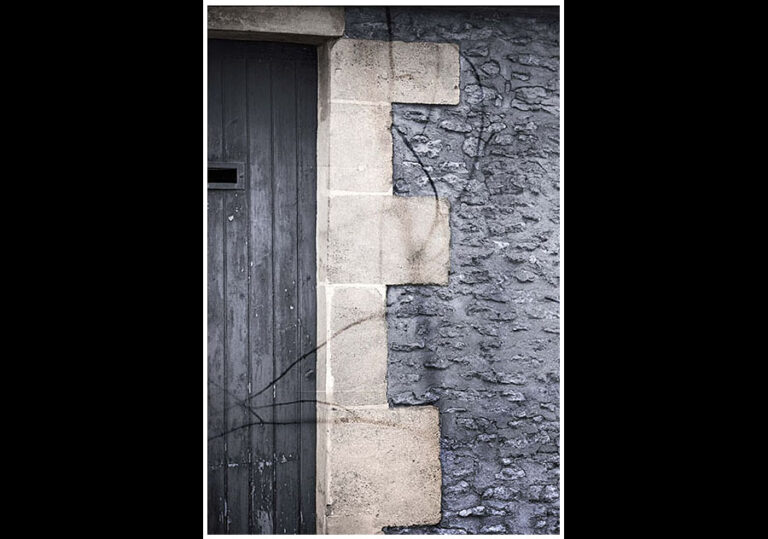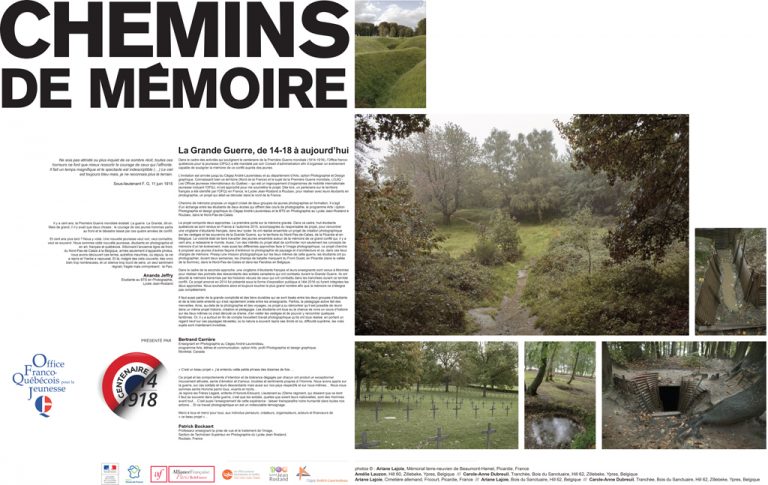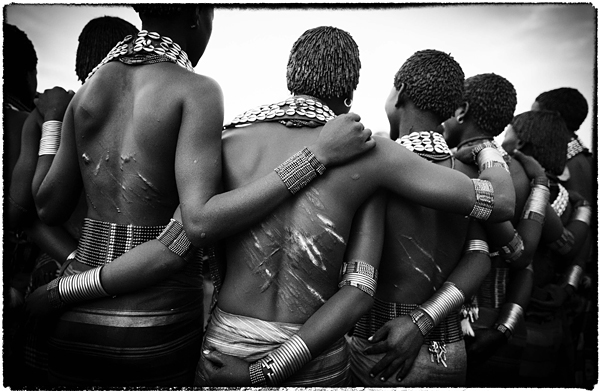Christine Moyns _ Pas.sages, derniers jours d’une école maternelle
En juin 2024, la nécessité de témoigner de la fermeture de l’école maternelle de sa ville la pousse à élaborer son premier projet photographique individuel, reportage qui aboutit en septembre à une exposition.
Elle aime mêler humour, politique, tendresse, poésie ; déceler la beauté dans le banal et le quotidien.